jardinerie poétique
Articles les plus récents
-

F.U.L.S. (Fonds Ultramarin Lucien Suel)
10 avril, par LM -

Revue géopoétique internationale
21 mars, par LMà paraître
-
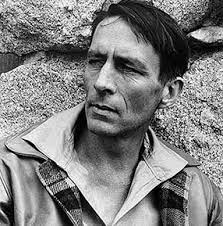
Robinson Jeffers
14 mars, par LMun poème
-

L’expérience poétique de la terre (1996-2024)
8 mars, par LMpublications de Laurent Margantin
-

Gary Snyder
4 mars, par LMun poème
-
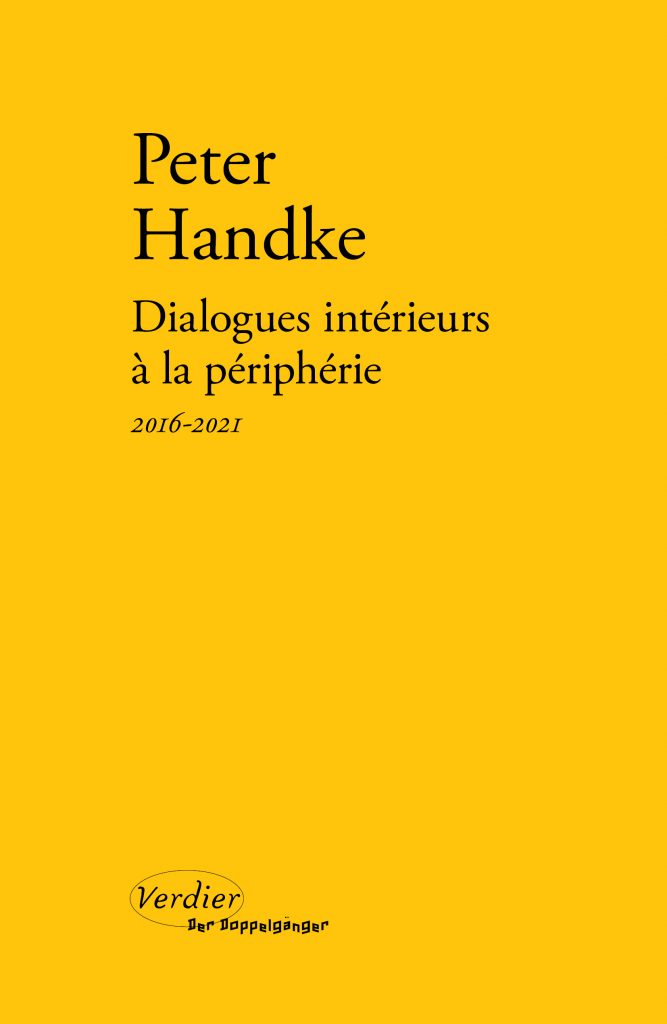
Peter Handke
1er mars, par LMà paraître en mai 2024
-
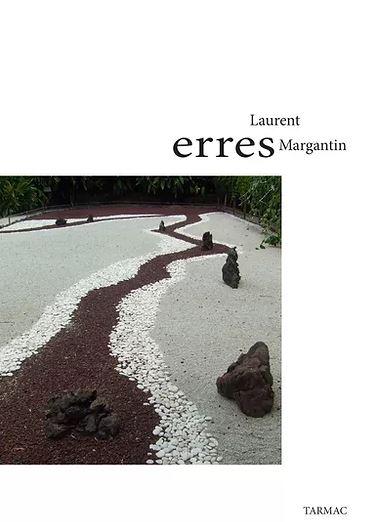
Erres
11 janvier, par LMPoèmes de Laurent Margantin
-
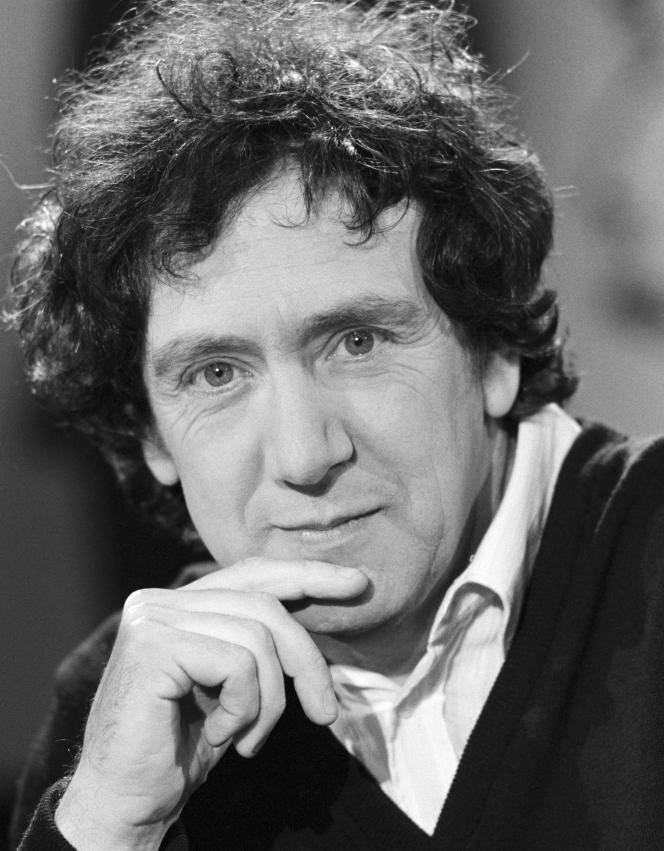
Le grand rivage de Kenneth White
11 janvier, par LM # géopoétique - Kenneth White - Laurent Margantinhommage au poète franco-écossais
-

Kenneth White et la géopoétique
10 janvier, par LMouvrage collectif dirigé par Laurent Margantin
-
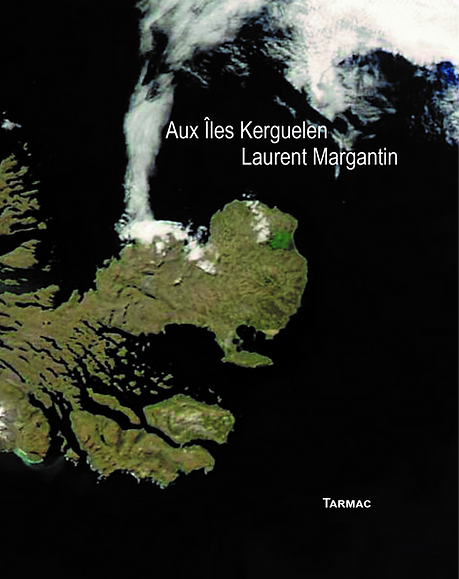
Aux îles Kerguelen
9 janvier, par LMrécit de Laurent Margantin aux éditions Tarmac